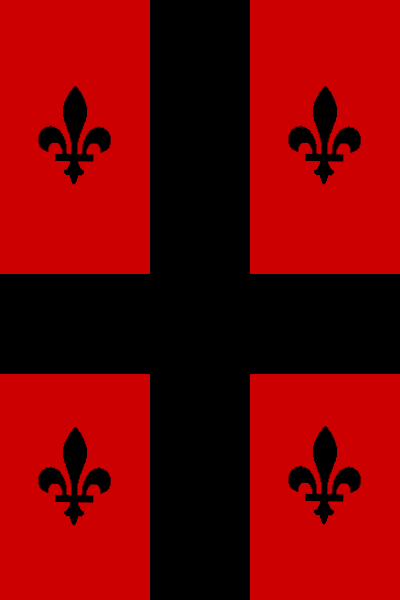Le taux de fréquentation des écoles privées par la classe moyenne pour la province de Québec
ERRATUM. Entre 2010 et 2014, j'ai véhiculé sur ce blogue un chiffre erroné sur le taux de fréquentation des écoles privées par la classe moyenne pour la province de Québec (1). Je tenais mes chiffres d'un article de 2010, d'un chroniqueur bien connu à Québec. Vérification faite avec deux études commanditées par la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP), chiffres de 2005 et de 2013, je ne sais pas d'où provenaient les statistiques sur les revenus de la clientèle utilisées par le journaliste; peut-être des données régionales et non de l'ensemble de la province de Québec? Je dois donc corriger le tir en révisant à la baisse les chiffres diffusés précédemment.
Malgré ce constat, nous sommes en mesure de voir que
- Les classes moyenne et de revenu inférieur constituent encore une bonne part de la clientèle du réseau d'enseignement privé au Québec (± le tiers des familles clientes ou un peu moins).
- Mais nous apprenons aussi que leur proportion fond littéralement parmi la clientèle des instituts d'enseignement privés autonomes (chiffres des instituts privés membres de la FEEP), qu'on peut comparer, entre les études de 2005 et de 2013, en se servant d'un calculateur de l'inflation (hausse du coût de la vie au Canada) entre ces années. La classe moyenne combinée à la classe de revenu inférieure seraient passées de plus de la moitié des clients, à près du tiers en seulement 8 ans. Comme si cela était programmé par les coupes au privé, lentement mais sûrement... Work in progress!
NOTE : Aux fins des calculs basés sur le revenu familial, le RFB désigne le revenu familial brut (revenu annuel brut par ménage).
1. Étude du CRIÉSÉ, 2013 (2)
Répartition des revenus selon l'étude de 2013: selon la plus récente étude, près du tiers des ménages (familles) clientes du réseau privé sont de la classe moyenne ou de revenu inférieur au Québec. C'est donc une partie importante de la clientèle.
Selon cette étude récente auprès des écoles membres de la FEEP, en 2013,
- la clientèle du réseau privé appartenant à un ménage (famille) à faible revenu est celle dont le revenu familial brut (RFB) en avril et mai 2013 est de moins de 53,250 $.
- Les ménages de la classe moyenne ont un RFB de 53,251 à 106,500 $.
- Les familles clientes considérées avec un revenu supérieur sont celles avec un RFB supérieur à 106,500$
- Cependant, la classification du CRIÉSÉ (Université de Sherbrooke), ajustée pour la présentation des résultats dans le tableau de 2013, n'a pas suivi strictement ces seuils statistiques. Donc, considérant les catégories retenues; on constate quand même que 28% (ou 21% + 7%) de la clientèle du réseau privé d'enseignement membre de la FEEP, a un RFB inférieur à 100,000$ (avril / mai 2013).
- MAIS, tentons d'estimer la partie de la classe moyenne non distinguée des familles de RFB supérieur (106,501$ et plus) au Tableau 3 de la page 12 de l'étude. N'ayant pas accès aux données brutes, il faut pour cela considérer la tranche de revenu familial, entre 100,000$ et 106,500$, à fusionner avec la définition statistique de la classe moyenne retenue au départ pour l'étude (p. 3-4). Comme il y a 5 tranches de 10,000$ pour 29 points de pourcentage dans la tranche 100,000 à 149,999$, il est logique de conclure ce qui suit. Près du tiers (1/3) de la clientèle des instituts d'enseignement privé membres de la FEEP, se situe dans les ménages de classe moyenne ou inférieure (soit 28% + une partie des 29 points actuellement fusionnée avec les seuils 100,000 à 149,999$). Bien qu'on ne puisse connaître le nombre exact de points en pourcentage (%) correspondant aux seuils 100,000-106,500$, on peut visualiser un ordre de grandeur: 28% + quelques points en pourcentage. Près du tiers (près de 1 famille sur 3) de ménages (familles) de classe moyenne ou de revenu inférieur composant la clientèle du réseau privé, constitue une estimation minimale tout à fait raisonnable en tenant compte des critères initiaux des seuils de définition des classes sociales (en dollars arrondis, faible revenu = moins de 53,250$; classe moyenne = 53,251 à 106,500 $, revenu supérieur = 106,501 et plus $, avec revenus des clients compilés en avril et mai 2013).
Dans les seuils retenus au Tableau 3 (2013), le seuil de «richesse» à 100,000$ et plus en revenu FAMILIAL (par ménage) relève davantage de l'arbitraire et de l'imaginaire québécois (une sorte de seuil psychologique plutôt qu'une mesure statistique et mathématique), (3). Mais il a été utilisé, «tenant compte de l’utilité du recours à la catégorisation de la variable revenu» (rapport du CRIÉSÉ, 2013) d'usage en statistiques au Canada.
 |
| Revenu familial brut des familles clientes des écoles privées du Québec membres de la FEEP, selon l'étude du CRIÉSÉ (Centre de recherche sur l'intervention éducative et socioéducative) de l'Université de Sherbrooke, réalisée en 2013 au Québec (revenus période avril / mai 2013). |
2. Étude de MASSÉ (2005) (4)
La précédente étude commanditée par la FEEP remontait à 2005 (8 ans avant celle de 2013).
Répartition des revenus selon l'étude de 2005
On constate que pour les revenus familiaux bruts (RFB) de 70,000$ et moins pour 2005, le réseau privé de l'époque comptait pour 37,5% de sa clientèle dans cette tranche de RFB. C'est près de 4 familles sur 10.
On peut estimer à l'aide d'un calculateur que la limite supérieure du revenu FAMILIAL de la classe moyenne en mai 2005 équivaut en tenant compte du coût de la vie, à un RFB de 93,004 $ CAD en dollars équivalents de mai 2013 (basé sur une équivalence avec le RFB limite de la classe moyenne, mai 2013: 106,500 $ CAD ). Chiffres basé sur une inflation de 12,67% entre 2005 et 2013.
3. Variation estimée en pourcentage de clientèle des classes moyenne et inférieure à l'école privée au Québec, mai 2005 à mai 2013
En prenant les paramètres suivants:
- seuil supérieur du Revenu familial brut (RFB) de classe moyenne; soit le montant au-dessus duquel une famille est considérée de revenu supérieur dans l'étude pour 2013: 106,500$
- ramené en dollars équivalents pour l'année 2005, d'après la hausse du coût de la vie; résultat estimé du seuil supérieur de la classe moyenne calculé en dollars équivalents de 2005 : 93,003.66 $ avec le calculateur de la Banque du Canada (basé sur l'indice des prix à la consommation -IPC- de biens et services de Statistique Canada)
- hausse du coût de la vie, Canada, 2005 à 2013: 14,51% (source: calculateur Banque du Canada et IPC de Statistique Canada, paramètres appliqués par le calculateur, au 6 octobre 2014)
- et en prenant dans le tableau de 2005, le seuil le plus rapproché du RFB de 93,004$ (valeur arrondie au dollar dans le tableau 2 ci-haut), 90,000$ pour 2005,
On arrive à une représentation (proportion) des classes moyennes et de revenu inférieur, avec un ordre de grandeur d'un minimum de 52% de la clientèle du privé en 2005, couvrant les revenus par famille de moins de 30,000$ jusqu'à à 90,000$ : (14,19% + 17,25% + 13,94% + 6,34%) = 51,725 ou env. 52% (lignes 3, 4, 5 et 6 du tableau 2 de 2005). Retenons 1 famille sur 2 et on ne se trompe pas pour la proportion.
En se servant des résultats ainsi calculés, tenant compte de l'inflation (dollars équivalents) pour estimer la part des familles de classe moyenne et inférieure, on arrive à la tendance suivante à la fin des années scolaires comparées (2005 vs 2013), l'année scolaire (de la maternelle au secondaire) se terminant en juin au Québec, donc tout près de la dates des enquêtes statistiques:
Estimation de l'évolution de la portion des familles de la classe moyenne et inférieure, clientes du réseau d'enseignement privé
(réf. instituts d'enseignement privés, membres de la FEEP)
- 2005 : un minimum estimé à 52% (globalement la moitié de la clientèle ou 1 famille sur 2)
- 2013 : un minimum de 28% auquel il faut cependant ajouter quelques points pour couvrir les familles avec un revenu compris entre 100,000 et 106,500$, donc près du tiers (1 famille sur 3). Sans connaître les chiffres exacts pour cette tranche, car nous n'avons pas accès dans le rapport aux données non catégorisées, on peut toute de même conclure sans trop se tromper, que près du tiers de familles de la classe moyenne (53,251 à 106,500 $) et de revenu inférieur (0$ à 49,999$) combinés composent la clientèle des écoles privées du réseau de la FEEP (voir calcul d'un ordre de grandeur au point 3 basés sur le tableau 3, données d'avril et mai 2013). Il faut en effet tenir compte de la tranche de RFB entre 100,000$ et 106,500$ de RFB, car le véritable revenu par logement en 2013 (retenu initialement aux fins de l'étude) pour la classe moyenne est 53,251 à 106,500 $, et non pas 50,000$ à 99,999$ (catégorie retenue aux fins de la présentation au tableau).
- Il s'agit d'une chute importante de la représentation des classes moyenne et inférieure en seulement 8 ans, soit une clientèle qui est passée de la moitié des familles (1 sur 2) à à peine le tiers.
C'est donc une baisse importante en seulement 8 ans qui indique que la classe moyenne jumelée à celle de revenu inférieur sont de moins en moins représentées dans le réseau d'enseignement privé.
Nous assistons donc à une dégradation de la démocratisation de l'enseignement privé, laquelle étrangement, amène un plus grand poids financier pour l'État pour soutenir 100% des coûts de la clientèle du réseau public. Si cela peut constituer un avantage pour les commissions scolaires (lorsque la capacité d'accueil est présente) et syndicats (cotisations des syndiqués), il s'agit d'une dépense additionnelle pour la province de Québec (donc pour l'ensemble des contribuables québécois). Car lorsqu'une famille de classe moyenne ou de revenu inférieur choisit le réseau d'enseignement public (maternelle au secondaire) faute de revenus suffisants pour le privé, elle n'injecte pas d'argent nouveau dans le réseau de l'éducation du Québec. Car elle paie déjà ses taxes, impôts et taxes scolaires. Le Gouvernement du Québec, doit quant à lui compenser la commission scolaire à laquelle se joint un enfant qui s'inscrit au public. Et d'où proviendra le manque à gagner entre le soutien d'un enfant au public versus ce même enfant au privé? De nouvelles taxes et impôts, sinon de l'augmentation de la dette de la province (5).
4. Conclusion : Nous assistons donc à une dégradation de la démocratisation de l'accès à l'enseignement privé et la social-démocratie du Québec ressemble de plus en plus à un socialisme occidental émergent, limitant de plus en plus les options et choix des citoyens.
Sans connaître le pourcentage précis de familles de la classe moyenne entre 100,000$ et le seuil supérieur de cette classe, 106,500$ du classement (tableau) retenu par le CRIÉSÉ (Université de Sherbrooke, 2013), on peut quand même dégager une tendance. La classe moyenne et celle de revenu inférieur fondent littéralement en tant que clientèle du réseau privé, passant de une personne sur deux de la clientèle en 2005, pour chuter à peine au maximum de représentation de une personne sur trois en 2013; baisse importante en seulement 8 ans (6).
Difficile de ne pas penser que c'est exactement ce que certains hauts-fonctionnaires de l'ombre, ainsi que les commissions scolaires et les syndicats réclament. Et que les gouvernements semblent leur accorder, non pas pour des économies (inexistantes car les coûts seront plus importants pour l'État québécois si d'autres familles quittent le réseau privé annulant leur investissement annuel dans le réseau), mais par principe idéologique.
On pourrait croire sans effort, que la social-démocratie du Québec ressemble de plus en plus à un socialisme occidental émergent, limitant de plus en plus les options et choix des citoyens. Il n'en faudrait pas beaucoup pour croire que nous sommes en train de migrer depuis la forme démocratique d'un État au service du peuple (l'État pour le bien-être du peuple), vers la forme un peuple au service (existant pour) l'État.
Serions-nous dans un socialisme émergent, dans lequel le peuple ne sert qu'à soutenir l'État, son idéologie, ses valeurs, en se faisant confisquer ses libertés de choix et son argent. Au 20e siècle, les idéologies semblables ont amené la disparition de la classe moyenne avant que l'économie de ces pays implose (s'effondre sur elle-même). Celles qui semblent tenir encore, n'ont d'apparentes richesses que près des grands hôtels touristiques. Mais dès que vous vous en éloignez, c'est la misère partagée (ex. Cuba en possible rapprochement avec les États-Unis).
LIRE AUSSI :
_______________
1. Les deux tiers avaient un revenu familial inférieur à 80,000$; 4 sur 10 avaient même un revenu familial de moins de 60,000$. Source: Jean-Jacques Samson, Journal de Québec, 13 juillet 2010.
(je n'ai pu déterminer d'où provenaient les chiffres du journaliste; peut-être une statistique de la région de la Capitale, plutôt que provinciale).
3. En effet, un revenu familial brut (RFB) de 100,000$ en 2013, n'a plus rien à voir avec 100,000 dollars en 2000, par exemple. Ainsi, un revenu familial brut de 100,000$ en 2013 équivaudrait à un RFB de 77,742$ en 2000 (au dollar arrondi), en considérant l'inflation (hausse du coût de la vie, en produits et services) selon la feuille de calcul (calculateur) de la Banque du Canada.
6. Il resterait toutefois à mon avis, un biais possible à vérifier, concernant la compréhension des répondants, particulièrement de la dernière enquête, auprès des clients des écoles privées membres de la FEEP. Les parents répondants ont-il bien saisi la notion de revenu par ménage, dans le contexte où il y a de plus en plus de familles éclatées (divorces ou séparations et familles monoparentales ou reconstituées). Comment, en tel cas, les personnes analysent-t-elles leurs revenus familial ou par ménage, selon le cas? Par exemple, une mère seule qui reçoit une allocation payée par l'ex-conjoint, calcule-t-elle son revenu seul (revenu personnel + allocation) ou autrement (somme des deux parents + allocation du conjoint pour enfant)? Si c'est le cas, des familles de la classe moyenne seraient considérées comme ayant un revenu supérieur à la classe moyenne. Par exemple, l'allocation pour l'enfant pourraient être comptée 2 fois: déjà comprise dans le revenu du père avant d'être une dépense et comme revenu pour la mère... En tout cas, il faudrait fouiller un peu plus cet aspect de l'interprétation du RFB pour des parents séparés ou divorcés, parent monoparental et famille reconstituée, revenu pris en compte en cas de garde partagée, ... et cela, au-delà de cette seule enquête. Quand calcule-t-on, ou non les revenus des deux parents? Ce n'est peut-être pas clair pour tous les répondants à ce genre d'enquête.