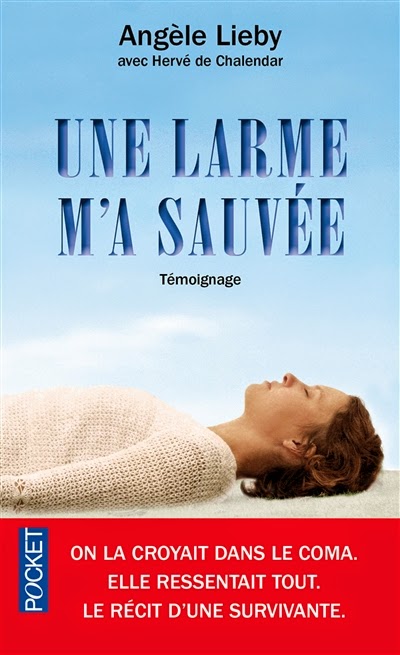Utopie du jour ET comment le maire Rob FORD est devenu possible à Toronto. Sur les demandes de pouvoirs largement augmentés des grandes villes, qui veulent s'affranchir des contrôles du palier de gouvernement au-dessus (les provinces), enfin un chroniqueur éveillé et qui réfléchit, en la personne de François BOURQUE dans La Presse/Le Soleil. Le titre: La grande illusion des «cités-États».
Mon commentaire
 |
| Ville de Québec, partie historique. Photo : Gilles B. YapasdePRESSE.blogspot.com, oct. 2009 |
Pour ma part aussi, l'idée voulant que les grandes villes comme Québec et Montréal avec des pouvoirs considérablement augmentés, feraient mieux que le gouvernement, je n'y crois pas. Sous une bonne administration, ce serait logiquement mieux. Sous une mauvaise, ce serait pire, car le palier de gouvernement au-dessus aurait moins de prise pour faire contre-poids. Par contre, je crois à la délégation de certains pouvoirs avec l'enveloppe budgétaire rattachée, MAIS dans le respect des lois existantes; non pas via des règles favorisant une grande ville en déshabillant une région.
Naissance d'une utopie en direct
Dès que j'ai entendu les attentes des maires de Montréal et de Québec pour des super-pouvoirs, j'ai tilté. Mais autour, dans les médias, tout le monde semblait séduit par l'idée. Comme lorsque naît une utopie qui réussit à séduire mais fondée sur de la mousse de bain. Dans le nouveau monde des grandes villes-États, tous les maires et hauts-fonctionnaires seraient compétents et équitables.
Naissance d'une utopie en direct
Dès que j'ai entendu les attentes des maires de Montréal et de Québec pour des super-pouvoirs, j'ai tilté. Mais autour, dans les médias, tout le monde semblait séduit par l'idée. Comme lorsque naît une utopie qui réussit à séduire mais fondée sur de la mousse de bain. Dans le nouveau monde des grandes villes-États, tous les maires et hauts-fonctionnaires seraient compétents et équitables.
- Il n'y aurait pas eu, pense-t-on, les dérives de Montréal.
- Les règles éthiques deviendraient aussi utiles qu'un gratte-dos, car tout le monde serait propre et pro-actif, à commencer par la métropole.
- Chacun rechercherait le bonheur de son prochain et le bien-être de sa cité, de sorte que les syndicats seraient par conséquent, utiles comme une souffleuse à neige (déneigeuse) à Palm Beach (1).
- Aux élections, il n'y aurait que des candidats/candidates solides, compétents, expérimentés, justes et équitables, à la fois très généreux et très économes.
Même certains animateurs des émissions de radios privées parlées, ont confessé leur foi dans ces séductrices «cités-États» et leurs «vaisseaux-maires». En choeur, deux d'entre eux ont chanté une ode, un matin de fin d'avril 2014. Ils ont déclaré: «je n'ai aucun problème avec cela»; «Moi non plus». Le «cela» désignant les éventuelles «cités-États» de Montréal et Québec. Et d'ajouter à peu près en ces termes: «ce sera à nous, après cela, à se donner des bons dirigeants». Je n'en croyais pas mes oreilles. Évidemment, au Québec, tout le monde vote avec logique...; faux. Les Québécois votent avec leurs émotions. Ils élèvent à une élection et ils punissent à la suivante, quitte à voter pour un parti qui sent mauvais. À la dernière élection de 2013 à Québec, l'actu-maire a presque été élu par acclamation, sans adversaire sérieux; dans une capitale de 0,6 millions de personnes. Combien de fois dans les élections tant provinciales que fédérales des dernières décennies, avons-nous entendu la même description, ou même dit, qu'il n'y avait pas d'alternative crédible, aux élus sortants. Et soudain, par une métamorphose digne des récents films sur les super-héros et sur les demi-dieux mythiques, nous aurions une panoplie de candidats offrant une alternative réelle. Je m'interroge. Jérôme LANDRY et son chum du matin à Radio X, ont-ils mangé des muffins au cannabis sans le savoir? Il faudrait contrôler ce qu'on leur livre en studio. Et à mon levé, ce samedi tant attendu, un chroniqueur, en la personne de François BOURQUE, avait pondu un excellent texte qui va dans le sens de ce que je voulais exprimer. Soulagement. Je ne suis pas le seul à avoir des réserves sérieuses.
Pour une véritable délégation de certains pouvoirs et budgets
Bien sûr, il y a des questions sur lesquelles les grandes villes ou villes-pôles régionales peuvent gagner à conserver ou se voir délégués des pouvoirs complets par la province. Je parle ici d'une véritable délégation d'un pouvoir, et non d'un chevauchement. Par exemple, une ville pourrait valider elle-même la conformité aux normes environnementales des grand projets de développement, mais par une voie plus rapide, du fait d'éliminer un intermédiaire. Cela se fait déjà en partie (inspecteurs municipaux), mais il faudrait vraiment un pouvoir délégué avec une enveloppe budgétaire. Moins de fonctionnaires au provincial, cela justifierait la transmission de l'enveloppe correspondante au municipal. Mais les grandes villes devraient appliquer les mêmes lois que le palier de gouvernement supérieur. Elles pourraient avoir plus de pouvoirs en main, dans des domaines comme le tourisme, l'environnement, etc. Mais la nouvelle vague des «supers-maires» veut aller beaucoup plus loin. On veut pouvoir décréter ce qui ne l'est normalement par les provinces; devenir des rois régionaux élus.
Baguette magique
La requête est basée sur une hypothèse hydilique. Selon celle-ci, le gouvernement d'une grande ville transformée en une sorte de royaume régional avec sa cour, deviendrait une ville bien gérée et sans problème, comme par un coup de baguette magique. Dans une «cité-État» au sens actuel, dans le contexte québécois, Montréal n'aurait pas été paralysée par la corruption et par le laxisme durant les dernières décennies. C'est une conception naïve, dont l'égale est que tous les problèmes se règlent avec plus d'argent. Alors que tout être responsable sait que bien souvent, les façons de faire et le tri dans les priorités, comptent pour une grande partie de la solution; en concentrant sur les choses essentielles. Dans une grande organisation, il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places et faire des choix d'offre, comme cela se fait en entreprise.
La grande variable oubliée de l'équation
La grande omission dans notre contexte nord-américain, c'est la